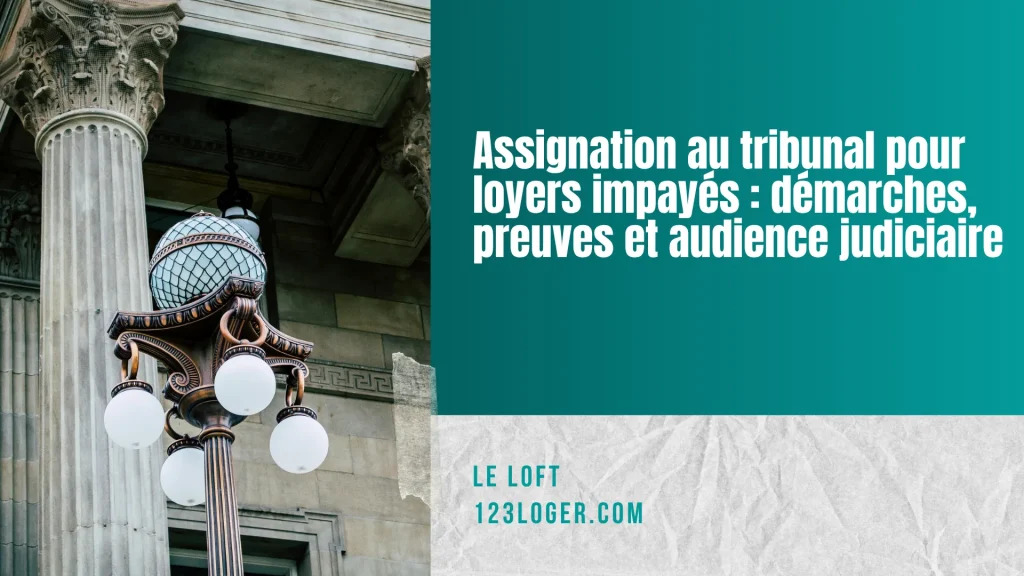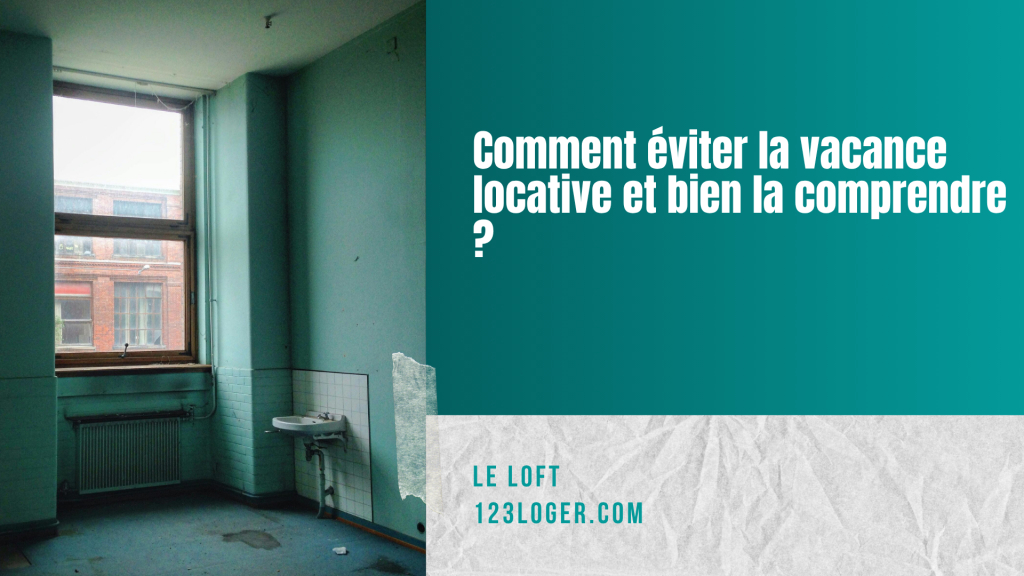Vous prévoyez de déménager ? Avant de boucler vos cartons, il est essentiel de bien comprendre comment fonctionne le préavis de votre logement. Cette étape clé du bail détermine le moment où vous pouvez quitter légalement votre logement sans risquer de litige. Durée du préavis, délais à respecter, exceptions selon le type de bail (vide ou meublé)… Les règles varient, et une erreur peut coûter cher.
Dans cet article, retrouvez tout ce qu’il faut savoir pour résilier votre bail sereinement, respecter vos obligations de locataire et partir l’esprit tranquille, sans stress, ni mauvaises surprises.
Préavis d’un logement, définition
Le préavis d’un logement est une étape incontournable dans toute location immobilière. Il s’agit d’un délai légal que le locataire doit respecter entre le moment où il annonce son départ et le moment où il quitte effectivement le bien qu’il occupe. Ce délai n’est pas arbitraire : il fait partie intégrante du contrat de location (ou bail) signé entre le bailleur (ou propriétaire) et le locataire, et vise à garantir un départ organisé et équitable pour chacun.
Le préavis sert donc à prévenir la résiliation du bail, tout en laissant le temps au bailleur d’anticiper la libération du logement. Cela lui permet de rechercher un nouveau locataire, d’organiser les visites et de planifier d’éventuels travaux, limitant ainsi la vacance locative.
Concrètement, le locataire manifeste sa volonté de mettre fin au bail à travers une notification écrite adressée à son propriétaire. Ce document, souvent appelé “congé” ou “lettre de résiliation”, marque le début du délai de préavis. Il officialise la volonté du locataire de rompre le contrat de location tout en respectant les obligations légales. L’objectif n’est pas seulement de quitter un logement, mais de le faire dans le respect des règles prévues par la loi (notamment la loi du 6 juillet 1989) et des termes du bail signé entre les deux parties.
Le préavis de logement représente donc un engagement mutuel : le locataire s’engage à libérer le bien dans un délai défini (et à payer le loyer et les charges durant toute cette période), et le propriétaire s’engage à faciliter la procédure dans le cadre prévu par la loi. Cette démarche, parfois perçue comme une simple formalité, joue pourtant un rôle essentiel dans la bonne gestion de la relation entre bailleur et locataire et dans la transition vers la fin du contrat.
Quelle est la durée du préavis selon votre situation ?
La durée du préavis dépend principalement du type de bail signé entre le locataire et le propriétaire du logement. En France, la loi encadre strictement ces délais afin de garantir un départ équitable pour les deux parties. Le but est d’assurer une transition harmonieuse entre la fin du contrat de location, l’état des lieux de sortie, et l’arrivée d’un nouveau locataire.
Le cas du logement vide (non meublé)
Dans le cas d’un logement vide, c’est-à-dire non meublé, le délai de préavis standard est fixé à trois mois. Ce délai, plus long, se justifie par le fait que le propriétaire aura potentiellement plus de difficultés à relouer un bien vide, qui s’adresse souvent à des locataires cherchant une installation durable.
Ce délai de trois mois commence à courir à partir de la réception effective de la lettre de préavis par le propriétaire (et non à la date d’envoi).
Cependant, de nombreuses situations permettent de réduire ce délai à un mois. C’est notamment le cas si le logement est situé en zone tendue (une exception devenue très fréquente), ou si le locataire justifie d’un motif légitime (mutation professionnelle, perte d’emploi, obtention d’un premier emploi, état de santé justifiant un changement de domicile, etc.). Ces exceptions, que nous détaillerons plus bas, doivent être explicitement mentionnées et prouvées dans la lettre de congé.
Le cas du logement meublé
Pour un logement meublé, la règle est plus souple et plus simple : le préavis pour le locataire est toujours d’un mois. Cette règle s’applique quelle que soit la localisation du bien (en zone tendue ou non) et le motif du départ.
Cette différence s’explique par la nature souvent plus temporaire de ce type de location (étudiants, mobilité professionnelle). La loi considère qu’il est plus rapide pour un bailleur de retrouver un locataire pour un bien déjà équipé.
Attention : Le bailleur, de son côté, doit respecter un préavis de trois mois s’il souhaite mettre fin au bail, et uniquement dans certains cas précis.
Dans tous les cas, le préavis logement doit être respecté à la lettre. Quitter son logement avant la fin du délai, sans un accord écrit du propriétaire, peut entraîner des conséquences financières sérieuses. Le locataire reste redevable du paiement du loyer et des charges jusqu’à la fin officielle du préavis, même s’il a déjà déménagé.
Dans quels cas peut-on réduire son préavis ?
Le préavis de trois mois pour un logement vide n’est pas toujours figé. Dans de nombreux cas précis, le locataire peut légalement réduire la durée de son préavis à un mois. Cette possibilité, largement encadrée par la loi ALUR, vise à faciliter la mobilité des locataires confrontés à des changements de situation personnelle ou professionnelle.
Encore faut-il connaître les motifs acceptés et savoir comment les justifier scrupuleusement auprès du bailleur. Si le motif n’est pas valable ou si le justificatif est manquant, le propriétaire est en droit de refuser la réduction et d’exiger les trois mois de loyer.
Les motifs professionnels
- Mutation professionnelle : qu’elle soit imposée par l’employeur ou demandée par le salarié, une mutation ouvre droit au préavis réduit.
- Perte d’emploi : licenciement, fin de CDD ou rupture conventionnelle. Une démission ou un départ à la retraite ne sont pas considérés comme une perte d’emploi ouvrant droit à réduction.
- Obtention d’un premier emploi (CDD ou CDI) : si vous étiez inactif et que vous signez votre premier contrat.
- Nouvel emploi suite à une perte d’emploi : si vous étiez au chômage et retrouvez un emploi.
Les motifs personnels et de santé
- État de santé : si l’état de santé du locataire (ou d’un membre de son foyer) justifie un changement de domicile (ex : besoin d’un logement en rez-de-chaussée, nécessité de se rapprocher d’un hôpital).
- Attribution d’un logement social : si vous quittez le parc privé pour un logement HLM.
- Bénéficiaires d’allocations : les locataires percevant le RSA ou l’AAH bénéficient de plein droit du préavis d’un mois.

Comment rédiger et envoyer sa lettre de préavis ?
Pour officialiser son départ et lancer le décompte du préavis, le locataire doit impérativement informer le bailleur par écrit. La lettre de préavis de logement n’est pas une simple formalité : elle marque le point de départ du délai légal et protège les deux parties en cas de désaccord. Sa rédaction doit donc être soignée, précise et conforme aux exigences du contrat de location.
Les mentions obligatoires
La lettre de préavis doit contenir au minimum :
- L’identité complète du locataire (ou de tous les cotitulaires du bail) et du bailleur.
- L’adresse complète du logement concerné.
- La date de départ souhaitée, calculée en respectant le délai de préavis applicable (un ou trois mois).
- La référence du contrat de location et la date de signature du bail initial.
- En cas de préavis réduit : le motif légal exact (ex : « logement situé en zone tendue ») et la mention des pièces justificatives jointes.
- La date et la signature de tous les locataires figurant sur le bail.
Exemple de formulation :
« Conformément aux dispositions du bail signé le [date], je vous informe de mon souhait de quitter le logement situé [adresse]. »
Les modes d’envoi acceptés
La lettre de préavis doit être envoyée par un moyen qui permet de prouver la date de réception. C’est cette date qui fait foi, et non la date d’envoi. Les trois moyens légaux principaux sont :
- Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) : le moyen le plus courant. Le préavis démarre le jour de la première présentation, même si le bailleur ne récupère pas le courrier.
- Remise en main propre contre récépissé ou émargement daté et signé.
- Acte d’huissier (commissaire de justice) : plus coûteux mais incontestable.
Depuis la loi ALUR, l’envoi par courrier électronique (email) est également possible, mais uniquement si le bailleur a explicitement donné son accord pour ce mode de communication dans le bail ou par avenant. En pratique, c’est risqué et déconseillé sans accord écrit clair.
Bon à savoir : les erreurs fréquentes à éviter
- Préavis non conforme : un préavis mal rédigé (oubli du motif de réduction) ou envoyé par un moyen non valable (email non autorisé, SMS, courrier simple) peut être contesté. Le bailleur peut exiger un nouveau préavis complet.
- Départ anticipé sans accord : quitter le logement avant la fin du préavis ne vous libère pas de vos obligations. Sans accord écrit du propriétaire, vous restez redevable des loyers et charges jusqu’à la fin officielle du bail.
- Oublier d’inclure la date précise de fin de bail : mentionner la date de fin calculée (ex : « le [date], soit trois mois après réception ») évite les ambiguïtés.
- Penser que le dépôt de garantie paie le dernier loyer : le dépôt de garantie sert à couvrir d’éventuelles dégradations, pas le dernier loyer. Le loyer doit être payé jusqu’au dernier jour du préavis.
- Négliger l’état des lieux de sortie : sans état des lieux de sortie, le bailleur peut en faire réaliser un par huissier à vos frais et conserver tout ou partie de la caution.

En résumé
Le préavis d’un logement est bien plus qu’un simple courrier : c’est une étape juridique qui encadre la fin du bail et protège à la fois le locataire et le propriétaire. En respectant les délais, les formes légales et les obligations de chacun, il est possible de quitter un logement sans conflit ni perte financière.
Un départ anticipé bien organisé, une lettre conforme et un dialogue clair avec le bailleur restent les meilleurs alliés d’une résiliation de bail réussie.
Pour que votre départ se déroule sans accroc jusqu’au bout, la récupération de votre dépôt de garantie est l’étape suivante. Découvrez nos conseils pratiques dans notre article : Combien de temps pour rendre une caution ?